Qui n’a pas reçu sur sa boîte de courrier électronique professionnelle un contact d’un agent commercial vous proposant un rendez-vous, parfois en vous invitant à cliquer sur son calendrier pour fixer le rendez-vous directement dans son calendrier très chargé ? Puis quelques semaines après que vous ayez supprimé ce message, une relance reprenant le message initial, et souvent au moins une troisième fois ensuite, vous reprochant presque de ne pas avoir fait attention au message précédent. C’est ainsi que se pratique aujourd’hui le « cold-emailing », ou comme ils le définissent eux-mêmes dans leurs documents de formation des « courriers électroniques envoyés à des prospects n’ayant pas particulièrement montré d’intérêt pour l’entreprise ou son offre commerciale.»
C’est une publicité vue sur twitter (pardon X) ce matin qui a fini de m’aiguillonner sur ce sujet et à écrire ce post dominical:
La publicité elle-même a été vue plus de 20 millions de fois depuis le 23 janvier 2024 et propose un lien vers ce fameux guide du cold-email, dans un document hébergé chez Google. On notera qu’il est publié par le compte d’un certain « Reio » travaillant pour la société instantly[.]ai, nous y reviendrons plus tard.
Le principe de la prospection à froid
L’idée générale derrière la prospection à froid est de susciter de nouveaux prospects par un contact direct envoyé à des adresses de courrier électronique professionnelles avec lesquelles l’agent commercial n’a jamais été en relations.
Sur le principe, la législation européenne en matière de prospection commerciale entre professionnels est assez permissive. Ainsi la CNIL rappelle sur son site Web (il faut cliquer sur l’onglet « Pour les professionnels B to B »:
- Principe général: information des personnes, opposition simple et gratuite
- Information au moment de la collecte, et être en mesure de s’opposer à ce moment-là (c’est souvent présenté comme une condition pour participer à des événements). La revente de ces données dans le contexte de la prospection de professionnels est légale et suppose de conserver la traçabilité de cette information et de la possibilité d’opposition.
- L’objet de la sollicitation doit être en rapport avec la profession de la personne démarchée
- Chaque message doit préciser l’identité de l’annonceur et proposer un moyen simple de s’opposer.
Le contenu du guide
Le contenu du guide nous plonge dans une autre réalité qui entoure ces démarches. L’objectif affiché du rédacteur de ce guide est de s’assurer que les messages arrivent bien dans la boîte de courrier électronique du destinataire (son « Inbox ») et non pas le répertoire des spams détectés de façon automatique.
La liste des recommandations qu’il apporte est la suivante:
- une étape technique consistant à créer de multiples noms de domaine et adresses de courrier électronique d’émission
- la configuration des mesures de sécurité du mail (SPF, DKIM et DMARC, protocoles qui empêchent d’usurper un domaine émetteur, mais qui n’empêche pas d’émettre du spam depuis un domaine créé pour cela)
- un domaine de traçage et la redirection vers le domaine propre du prospecteur.
En effet, la démarche qu’ils proposent est de découper le volume de messages à envoyer par autant de domaines et d’adresses pour ne pas être détecté par les seuils automatiques de classement en spam des récepteurs! Dans le cadre des envois massifs de spams classiques (messages publicitaires par opposition à la prospection directe évoquée ici), on utilise souvent le terme de « snowshoeing » pour décrire cette méthode.
Le guide recommande ensuite de « préchauffer » les adresses de courrier électronique. Il s’agit ici d’envoyer des messages anodins entre les adresses d’émission préparées pour qu’il y ait un trafic légitime aux yeux des grandes plateformes de messagerie. La société en question offre d’ailleurs un service (payant évidemment) automatisé pour simuler ces messages. Ils recommandent de maintenir l’activité fictive de « préchauffage » tout au long des opérations.
En résumé, ces pratiques et les services de ce type d’entreprises visent ouvertement à tromper et contourner les mesures de protection contre le spam.
Ensuite, pour le contenu même des messages envoyés aux prospects, l’auteur recommande de personnaliser les messages évidemment et de varier le vocabulaire utilisé d’un message à un autre, grâce à des modèles de textes alternatifs (et une fonctionnalité incluse dans son produit évidemment pour automatiser tout cela). Ils expliquent très bien eux-mêmes pourquoi c’est nécessaire: encore pour tromper la détection de spams.
On retrouve le même genre de conseils sur les sites de « conseil » pour la publication automatique sur les comptes de réseaux sociaux (pour ceux qui sont sur X récemment, on aura noté que la technique n’est pas tellement utilisée par les campagnes de spam pornographiques qui répètent des milliers de fois le même message « mes nus dans mon profil » sans apparemment être détectés par X).
La suite des recommandations est dans la même veine pour tromper le destinataire cette fois-ci. Ainsi, il recommande de fabriquer l’objet (le sujet) des messages de nature à inciter le destinataire à ouvrir le message, par exemple en combinant prénom et un mot simple comme « question » ou « pouvez-vous aider? ».
Pour finir de se convaincre du peu de sérieux de cette entreprise américaine, une visite sur son site Web confirme assez rapidement la première impression: les liens présents en bas de page et intitulés « Don’t sell my info » (ne vendez pas mes informations) et « Privacy Center » renvoient toutes deux vers des pages d’erreur.
Résumé et conseils
Comme je l’évoquais plus haut, la législation européenne n’interdit pas de contacter des prospects professionnels pour des produits ou services qui sont susceptibles de les intéresser. Mais utiliser des méthodes déceptives vis-à-vis des acteurs techniques et des destinataires des messages pour les inciter à transmettre, ouvrir et répondre aux messages est à l’opposé de toute éthique professionnelle. En outre, comme les destinataires ont vite fait de comprendre ces manœuvres après un ou deux messages insistants du même type, ils finissent systématiquement dans la corbeille, c’est totalement contre-productif. Et je note que malheureusement de nombreux acteurs recommandent ces méthodes: on retrouve toujours de nombreuses publications sur LinkedIn en français qui décrivent ces méthodes et proposent des formations à ces outils.
Mes conseils:
- comme d’habitude, informez-vous et discutez de ces méthodes abusives autour de vous;
- réfléchissez avant d’ouvrir un message ou de cliquer sur un lien, en particulier si vous ne connaissez pas l’émetteur;
- contribuez à lutter contre ces abus et signalez les messages que vous estimez inappropriés: n’hésitez pas à installer le module de signalement de Signal-Spam (c’est totalement gratuit), il vous permet non seulement de signaler un message abusif en un clic mais vous protège aussi des URLs malveillantes connues dans votre navigateur Web ou votre logiciel de courrier électronique.

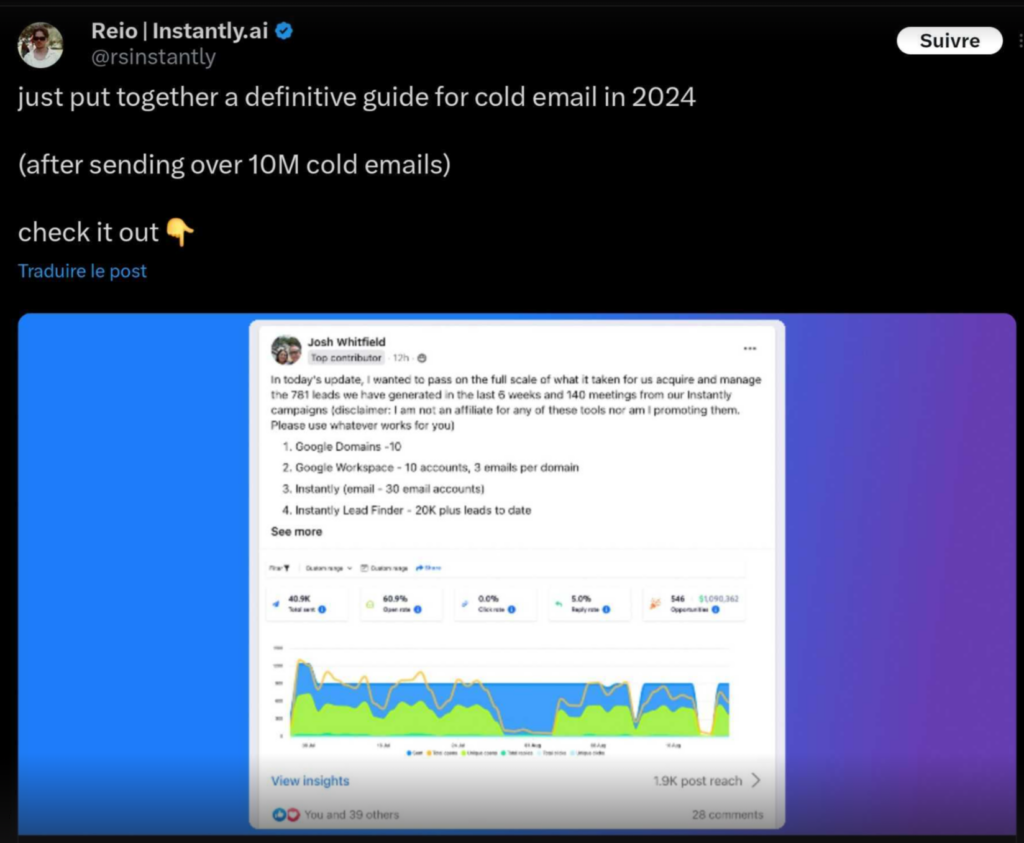
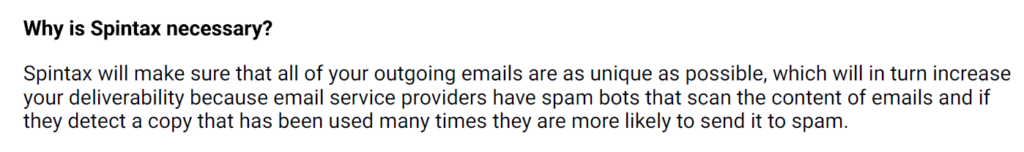


 Après un long silence, ce billet sur la notification des incidents de sécurité, et en particulier ceux qui relèvent de détournements de données à caractère personnel. L’actualité nous en apporte effectivement l’exemple avec le cas de la société Orange
Après un long silence, ce billet sur la notification des incidents de sécurité, et en particulier ceux qui relèvent de détournements de données à caractère personnel. L’actualité nous en apporte effectivement l’exemple avec le cas de la société Orange 
